Laura Brignon : profession traductrice

Les traductrices et les traducteurs tiennent un rôle primordial dans le monde de l’édition. Grâce à eux, nous pouvons découvrir des romans et autres ouvrages du monde entier. Chargés de rester fidèles au style de l’auteur qu’ils traduisent, ils évoluent néanmoins un peu dans l’ombre, même si leur rôle est davantage mis en valeur par certains éditeurs et salué par les auteurs eux-mêmes.
Originaire du département du Tarn, Laura Brignon travaille dans la traduction d’ouvrages italiens depuis plusieurs années. Responsable de la traduction de romans pour de prestigieuses maisons d’édition, Laura a accepté de répondre à nos questions afin de nous permettre de mieux connaître ce métier passionnant.
Comment es-tu devenue traductrice ? Visais-tu cette profession depuis le début de tes études ?
Quand j’étais au lycée, puis quand j’ai commencé mes études, j’adorais faire des versions et je savais que les traducteurs littéraires existaient, mais je n’imaginais pas du tout que c’était un métier dont on pouvait vivre. Il m’est arrivé quelquefois de traduire des petits bouts de textes italiens qui me plaisaient pour mes proches, mais comme ça, pour le plaisir. Comme je ne savais pas trop quoi faire, j’ai commencé à préparer le concours de prof d’italien, à l’époque on pouvait le passer avec une licence, mais sans grande conviction, je dois dire. Et puis, par hasard, j’ai rencontré une traductrice (c’était ma voisine de palier !), et là ça a été le déclic.
Pourrais-tu nous parler de ton parcours scolaire ?
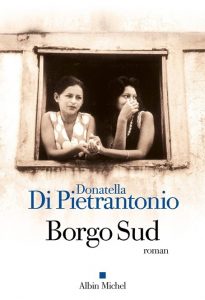 J’ai fait un bac L, où les enseignements principaux étaient les matières littéraires, puis une classe préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne), une licence LLCE d’italien, un master de traduction et, plus tard (j’avais déjà commencé à traduire des livres), une thèse en littérature italienne sur des questions de traduction.
J’ai fait un bac L, où les enseignements principaux étaient les matières littéraires, puis une classe préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne), une licence LLCE d’italien, un master de traduction et, plus tard (j’avais déjà commencé à traduire des livres), une thèse en littérature italienne sur des questions de traduction.
Tu traduis donc des ouvrages italiens en français. Comment l’italien s’est-il imposé ?
Là aussi, par hasard – je n’ai pas d’origines italiennes. En fait, tout est parti d’un voyage scolaire en Italie quand j’étais au collège. Le séjour a vraiment été très court, on a passé la plupart du temps dans le bus, mais le peu que j’ai vu du pays m’a beaucoup marquée. En rentrant, j’ai décidé que j’apprendrais l’italien, et j’ai pris cette langue comme LV3 quand je suis entrée en seconde. Et là, j’ai eu de la chance en rencontrant une super prof, très motivante et très rigoureuse, qui organisait des échanges chaque année avec l’Italie. Et c’est dans ce cadre que j’ai tissé mes premiers liens d’amitié avec des Italiens. À partir de là, les voyages et les séjours là-bas se sont multipliés, ainsi que les liens amicaux. Aujourd’hui, je suis incapable d’imaginer ce qu’aurait pu être ma vie sans l’italien et l’Italie.
D’après toi, quelles sont les qualités requises pour faire un.e bon.nne traducteur.trice ?
Un peu pêle-mêle : beaucoup de curiosité, de rigueur et de patience (parfois, le sens « résiste » et, souvent, on met longtemps à trouver une formulation satisfaisante), une grande capacité d’écoute, un petit côté obsessionnel, de l’intransigeance envers soi-même, un bon bagage littéraire, une grande aisance avec le français, qui est notre outil de travail, évidemment une très bonne connaissance de la langue d’origine, mais aussi de la culture, de l’histoire, etc. du pays en question, une passion pour la lecture… Après, ce sont aussi des choses qui se développent au fur et à mesure, et qui d’ailleurs n’arrêtent jamais de se développer, même quand on a plus d’expérience. C’est un des aspects que j’aime beaucoup dans ce métier : on n’arrête vraiment jamais d’apprendre.
La traduction de romans implique de respecter le style de l’auteur. Malgré tout, est-ce qu’il est nécessaire parfois de devoir prendre des décisions pour interpréter des passages ?
Oui, bien sûr, et même, en réalité, on fait ça en permanence. Par essence, la traduction demande constamment de faire des choix : pourquoi, par exemple, quand pour traduire un mot, on a le choix entre trois synonymes, on en choisit un plutôt qu’un autre ? Ce qui fait le cœur de la traduction, et qui est abyssal, c’est la notion de subjectivité. Un.e traductrice.teur tâche toujours de respecter le style de l’autrice ou de l’auteur, mais tel qu’il/elle l’a perçu avec sa propre sensibilité, tel qu’il/elle l’a compris. Au fond, c’est sa propre lecture qu’il/elle partage. Et il/elle va tâcher de le recréer dans une autre langue, mais en se servant de ses propres mots, de sa propre sensibilité. De la sorte, il existe autant de traductions possibles que de traductrice.teurs pour un même texte original.
Selon toi, quel aspect de ton métier est le plus complexe ?
Outre les questions purement matérielles, qui sont loin d’être négligeables (les traductions littéraires sont rémunérées sous le régime du droit d’auteur, les traductrice.teurs ne sont pas salarié.es et n’ont pas droit au chômage, on a un contrat pour chaque livre, donc il est très difficile d’avoir de la visibilité, c’est un métier précaire), je dirais que c’est le doute. Comme on doit faire des choix à chaque instant pour construire notre traduction, on se questionne forcément sur leur bien-fondé, leur pertinence. Et c’est aussi un métier solitaire, où chacun travaille de chez soi, ce qui fait qu’on n’a pas beaucoup d’occasions de discuter avec des collègues et de se confronter sur nos choix.
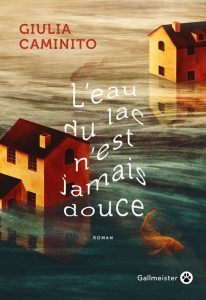
Tu as déjà traduit une cinquantaine de livres (essentiellement des romans), pour des éditions prestigieuses comme Flammarion, Gallmeister, Albin Michel ou encore HarperCollins. Comment se fait-on connaître en tant que traductrice.teurs ? À plus forte raison quand on débute ?
La traduction littéraire est un milieu assez fermé, où il faut se faire un réseau. Sauf que quand on débute et qu’on ne connaît personne, ce n’est pas évident. Pour ma part, ça s’est fait petit à petit, d’abord par un stage dans une maison d’édition, puis par des rencontres dans les salons du livre, puis grâce à l’aide de collègues déjà bien installé.es. Et aussi en proposant moi-même des textes inédits que je trouvais intéressants à des maisons d’édition. Ensuite, quand on a déjà traduit quelques titres, le bouche à oreille fonctionne. Mais tout cela prend beaucoup de temps, sans garantie absolue de réussite, ou d’activité suffisante pour pouvoir en vivre.
Quels conseils donnerais-tu à un lycéen qui souhaite se lancer dans une carrière de traductrice.teur ?
D’en avoir vraiment envie, pour pouvoir traverser les moments de découragement sans renoncer, de lire tous azimuts, dans la langue d’origine et (surtout, peut-être) en français, d’être curieux, de se renseigner auprès des gens qui font déjà ce métier, pour rassembler un maximum d’informations et s’assurer que ce parcours peut lui plaire.
Combien de temps mets-tu en moyenne pour traduire un roman ?
C’est très variable, et ça dépend beaucoup des délais que j’arrive à négocier ou pas avec les maisons d’édition. Disons que ça oscille entre quelques mois et un an, en gros.
Tu as signé une pétition concernant l’utilisation de l’IA dans la traduction et plus globalement dans la création humaine. Peux-tu nous en parler ?
L’intelligence artificielle générative a fait des progrès fulgurants ces dernières années, entre autres dans le domaine de la traduction (avec des logiciels comme DeepL, par exemple). Tant et si bien que le secteur de la traduction littéraire, qui se croyait à l’abri de l’utilisation de l’IA, commence lui aussi à être touché, marginalement pour le moment, mais les choses vont très vite. Le problème, c’est que ce métier, comme d’autres, est fondé sur la créativité humaine, et que recourir à l’IA pour de la traduction littéraire relève de l’absurdité. Car l’IA n’est pas créative, et en fait, elle ne traduit pas, elle propose des résultats issus d’un pillage des ressources textuelles existantes en se fondant sur des statistiques. S’il n’y a pas de réglementation sérieuse de son usage, ce qui se profile, c’est que les traductrices.teurs seront de plus en plus amené.es, plutôt que de traduire, à réviser des textes sortis de la machine, pour un tarif beaucoup plus bas et dans délais beaucoup plus courts. Sauf que cela les prive d’un moment fondamental de leur travail, qui est le premier jet, à savoir la première version qu’ils/elles font d’une traduction, où ils/elles entrent pleinement dans le texte, se posent mille questions, commencent à établir leurs choix stylistiques, etc., car leur cerveau n’est plus dans une démarche de création mais d’accommodement avec ce que la machine a produit. Au-delà des menaces matérielles pour le métier de traductrice.teur, ce qui se dessine avec le recours à l’IA, c’est donc une standardisation, un écrasement du style dans ce qu’il a de singulier, d’étrange, d’audacieux, bref un renoncement collectif à la diversité et à une qualité profondément humaine : l’imagination.




